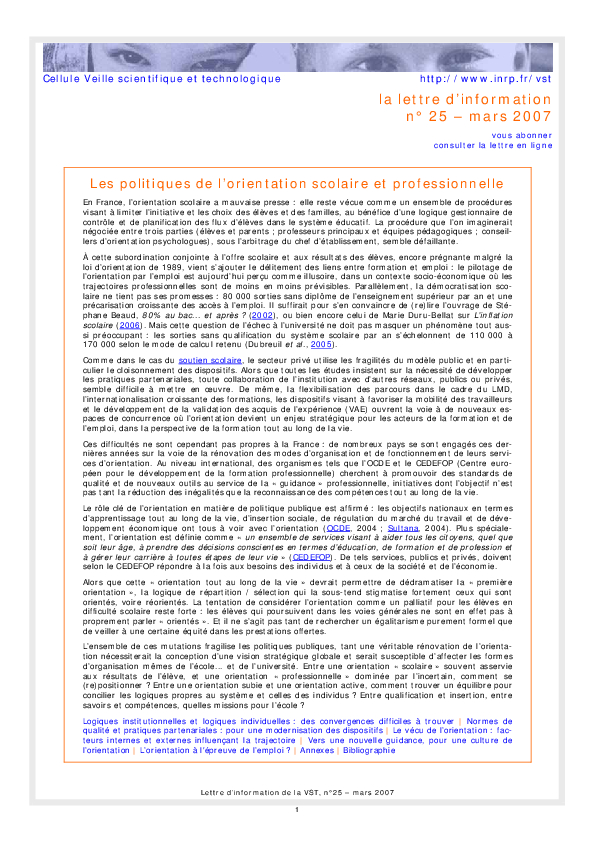
En France, l'orientation scolaire a mauvaise presse : elle reste vécue comme un ensemble de procédures visant à limiter l'initiative et les choix des élèves et des familles, au bénéfice d'une logique gestionnaire de contrôle et de planification des flux d'élèves dans le système éducatif. La procédure que l'on imaginerait négociée entre trois parties (élèves et parents ; professeurs principaux et équipes pédagogiques ; conseillers d'orientation psychologues), sous l'arbitrage du chef d'établissement, semble défaillante.
À cette subordination conjointe à l'offre scolaire et aux résultats des élèves, encore prégnante malgré la loi d'orientation de 1989, vient s'ajouter le délitement des liens entre formation et emploi : le pilotage de l'orientation par l'emploi est aujourd'hui perçu comme illusoire, dans un contexte socio-économique où les trajectoires professionnelles sont de moins en moins prévisibles. Parallèlement, la démocratisation scolaire ne tient pas ses promesses : 80 000 sorties sans diplôme de l'enseignement supérieur par an et une précarisation croissante des accès à l'emploi. Il suffirait pour s'en convaincre de (re)lire l'ouvrage de Stéphane Beaud, 80% au bac... et après ? (2002), ou bien encore celui de Marie Duru-Bellat sur L'inflation scolaire (2006). Mais cette question de l'échec à l'université ne doit pas masquer un phénomène tout aussi préoccupant : les sorties sans qualification du système scolaire par an s'échelonnent de 110 000 à 170 000 selon le mode de calcul retenu (Dubreuil et al., 2005).
Comme dans le cas du soutien scolaire, le secteur privé utilise les fragilités du modèle public et en particulier le cloisonnement des dispositifs. Alors que toutes les études insistent sur la nécessité de développer les pratiques partenariales, toute collaboration de l'institution avec d'autres réseaux, publics ou privés, semble difficile à mettre en oeuvre. De même, la flexibilisation des parcours dans le cadre du LMD, l'internationalisation croissante des formations, les dispositifs visant à favoriser la mobilité des travailleurs et le développement de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ouvrent la voie à de nouveaux espaces de concurrence où l'orientation devient un enjeu stratégique pour les acteurs de la formation et de l'emploi, dans la perspective de la formation tout au long de la vie.
Ces difficultés ne sont cependant pas propres à la France : de nombreux pays se sont engagés ces dernières années sur la voie de la rénovation des modes d'organisation et de fonctionnement de leurs services d'orientation. Au niveau international, des organismes tels que l'OCDE et le CEDEFOP (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) cherchent à promouvoir des standards de qualité et de nouveaux outils au service de la « guidance » professionnelle, initiatives dont l'objectif n'est pas tant la réduction des inégalités que la reconnaissance des compétences tout au long de la vie.
Le rôle clé de l'orientation en matière de politique publique est affirmé : les objectifs nationaux en termes d'apprentissage tout au long de la vie, d'insertion sociale, de régulation du marché du travail et de développement économique ont tous à voir avec l'orientation (OCDE, 2004 ; Sultana, 2004). Plus spécialement, l'orientation est définie comme « un ensemble de services visant à aider tous les citoyens, quel que soit leur âge, à prendre des décisions conscientes en termes d'éducation, de formation et de profession et à gérer leur carrière à toutes étapes de leur vie » (CEDEFOP). De tels services, publics et privés, doivent selon le CEDEFOP répondre à la fois aux besoins des individus et à ceux de la société et de l'économie.
Alors que cette « orientation tout au long de la vie » devrait permettre de dédramatiser la « première orientation », la logique de répartition / sélection qui la sous-tend stigmatise fortement ceux qui sont orientés, voire réorientés. La tentation de considérer l'orientation comme un palliatif pour les élèves en difficulté scolaire reste forte : les élèves qui poursuivent dans les voies générales ne sont en effet pas à proprement parler « orientés ». Et il ne s'agit pas tant de rechercher un égalitarisme purement formel que de veiller à une certaine équité dans les prestations offertes.
L'ensemble de ces mutations fragilise les politiques publiques, tant une véritable rénovation de l'orientation nécessiterait la conception d'une vision stratégique globale et serait susceptible d'affecter les formes d'organisation mêmes de l'école... et de l'université. Entre une orientation « scolaire » souvent asservie aux résultats de l'élève, et une orientation « professionnelle » dominée par l'incertain, comment se (re)positionner ? Entre une orientation subie et une orientation active, comment trouver un équilibre pour concilier les logiques propres au système et celles des individus ? Entre qualification et insertion, entre savoirs et compétences, quelles missions pour l'école ?
Télécharger la version intégrale (version PDF)

